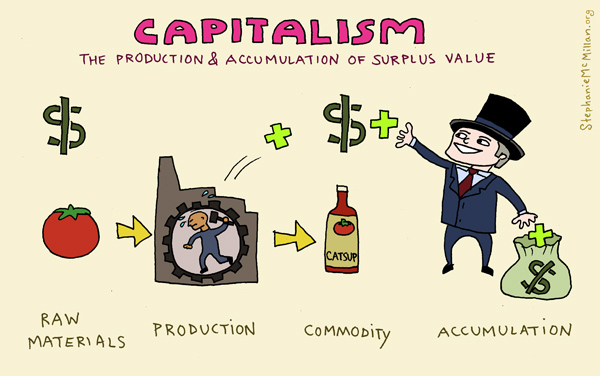Dans les années 1940-50, le cinéma constitue l’un des rares secteurs de la production culturelle où l’investissement capitaliste et la division du travail sont très avancés, suivant le modèle établi à Hollywood.
Les autres secteurs se caractérisaient encore par la production de type artisanal, où l’individualisation de l’œuvre conservait encore toute son importance.
Le concept d’industrie culturelle se forme dans ce contexte d’émergence des médias de diffusion massive (radio, télé).