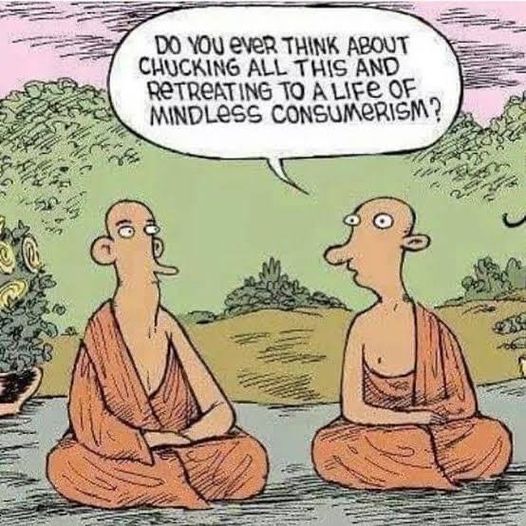Les émissions de gaz à effet de serre provenant des investissements de 125 milliardaires à travers le monde équivalent chaque année à celles d’un grand pays comme la France, soit 393 millions de tonnes d’émissions en équivalent carbone. […]
Prises individuellement, les émissions de chacun de ces milliardaires sont un million de fois plus élevées que celles de n’importe quelle personne n’appartenant pas aux 10% les plus riches de l’humanité.
Le rapport Les milliardaires du carbone s’appuie sur une analyse détaillée des investissements faits par 125 des milliardaires les plus riches dans certaines des plus grandes entreprises du monde, et des émissions de carbone liées ces investissements. Ensemble, ces milliardaires détiennent une participation de 2400 milliards de dollars dans 183 entreprises.
Le rapport révèle que ces investissements produisent une moyenne annuelle de 3 millions de tonnes de CO2e, soit un million de fois plus que les 2,76 tonnes de CO2e produites individuellement par 90 % de l’humanité. Ces émissions s’ajoutent à celles liées à leur mode de vie et à leur consommation personnelle.
Ce total est probablement encore plus élevé, puisqu’il a été démontré que les émissions dévoilées par les entreprises sous-estiment systématiquement leur véritable impact sur l’environnement. Par ailleurs, les milliardaires et les entreprises qui ne révèlent pas publiquement leurs émissions, et qui n’ont donc pas pu être inclus dans l’analyse, sont peut-être ceux dont l’impact climatique est le plus élevé.